Connexion
Le XVIème siècle
flsh agadir dllf :: Langue et littérature :: Littérature française, courants et mouvements littéraires, poètes, écrivains
Page 1 sur 1
 Le XVIème siècle
Le XVIème siècle
Cadre historique : les emportements du siècle
Le XVI e s. est un beau désordre, et pour cette raison, on le pratique peu.
On se rappelle pourtant la rose de Ronsard, la verdeur de Rabelais, ou le regard ferme et velouté du roi François. Période turbulente, où l’épaisseur du drame côtoie le charme du factice, mais aussi ensemble de moments unique où toutes les possibilités ont été promises. On y trouvera autant de tyrannie dans les lettres que dans la société, mais aussi autant de risques et d’inventions.
Croissances et guerres extérieures (1470-1559)
La guerre de Cent Ans terminée et Charles le Téméraire disparu (1477), la politique de Louis XI en matière d’annexions royales et les nouveaux espoirs qui animent l’Europe annoncent une période de prospérité relative.
Grâce à une démographie favorable, la France, pays le plus peuplé (15 à 18 millions d’habitants), voit sa production augmenter. Les guerres n’affectent pas l’intégrité territoriale et concentrent l’énergie belliqueuse des Grands vers l’extérieur, une Italie enviée pour sa richesse en hommes et en arts, et faible politiquement. Ce sont les dernières guerres de conquête, même si Henri II continue à opérer contre l’Espagne.
Les rêves de gloire des premiers rois s’accompagnent d’une rêverie générale sur la « concorde universelle » soutenue par les humanistes français et les admirateurs d’Erasme, à l’opposé du pragmatisme de Machiavel. La « concorde » se confond souvent, chez Charles Quint ou François Ier, avec la tentation de « monarchie universelle »où le désir d’unité s’appuie sur l’adhésion forcée. Le prétexte religieux existe toujours car il s’agit de construire une chrétienté unie contre le péril ottoman. Mais ce schéma est progressivement remplacé par la conscience d’une Europe aux intérêts divisés, surtout quand elle ne pourra plus prétendre à l’unité religieuse.
Tous les espoirs sont permis à une époque où l’aisance s’installe, même dans les campagnes. Partout en Europe, le capitalisme se développe avec la pratique du crédit et le prêt, encore à des taux usuraires, se généralise.
Pendant ces années fastes, la puissance royale s’affermit et tend à se confondre avec l’Etat. Machiavel admire ce pays où « le roi est obéit », notamment grâce aux réformes administratives, à l’organisation des postes et à l’intervention des commis, fonctionnaires temporaires mais efficaces. Le roi doit asseoir son autorité en diminuant celle des autres : les grands féodaux sont concurrencés dans les conseils par des clercs ou des bourgeois ; les Etats généraux ne sont pas convoqués entre 1484 et 1560 ; les parlements doivent lutter contre les ordonnances royales avec leurs « remontrances » ; les gouverneurs des provinces, souvent enclins à l’autarcie, voient leurs prérogatives diminuer. Mais c’est surtout le clergé qui doit entrer dans la politique monarchiste depuis le concordat de Boulogne (1516) par lequel le roi de France a le droit de « contrôler » les nominations des évêques et abbés.
Déjà aimés de Louis XII, les arts trouvent chez François Ier un véritable encouragement, car ils servent aussi à illustrer sa cour et lui-même.
Les menaces ne manquent pas à ce demi-siècle de stabilité et dès 1540, les signes avant-coureurs d’une crise se font sentir : la paupérisation augmente, car le pouvoir d’achat va baisser des deux tiers.
Les querelles religieuses évoluent aussi vers le conflit. Après l’excommunication de Luther (1525), les partisans d’une réforme modérée de l’Eglise savent qu’il sera de plus en plus difficile de se faire entendre. Le roi protège pourtant les nouvelles idées, sous l’influence de sa sœur, jusqu’à l’affaire des placards (1534) et ses autres accès répressifs (1538, 1544). L’hérésie est traquée de façon permanente par Henri II et ses édits intolérants. Il est vrai que l’hérésie s’organise rapidement : depuis 1540, Calvin la dirige de Genève en formant des ministres. Des provinces entières (Languedoc, Quercy, Dauphiné) sont acquises à la Réforme et réclament des droits.
En 1557, une tentative de colonisation française dans la baie de Rio de Janeiro échoue : elle consacre la médiocrité des conquêtes maritimes françaises.
Le « théâtre tragique de l’humaine fortune » : récession et guerres civiles (1560-1610)
François Ire avait laissé en mourant une dette énorme, et Henri II la banqueroute. Le coût des dernières campagnes a été considérables ; les rentes de l’État sont irrégulièrement payées et les emprunts forcés saignent les villes. De sérieuses famines sont aggravées par des épidémies. Les salaires sont restés fixes et même le clergé, sollicité pour payer la lutte contre l’hérésie, voit ses revenus diminuer.
Il n’y a jamais eu vraiment de paix entre 1562 et 1598. Les provinces réformées constituent un véritable État dans le Midi, sous la direction de princes comme Condé, les Coligny et Henri de Navarre. Les Grands qui n’ont pas admis l’autorité royale tentent de s’en affranchir et les Guise, cousins du roi et oncles de la reine, de se l’approprier. L’habileté et les hésitations de Catherine de Médicis jouent dans le sens de la conciliation jusqu’à ce qu’elle devienne la « Jézabel » de la Saint-Barthélemy (1572).
Les protestants rêvent de monarchie élective avant que le passage de la couronne à Henri de Navarre n’encourage le tyrannicide ; les défauts multiples d’Henri III sont autant de justifications à l’insurrection, surtout du côté des Ligueurs qui passeront à l’acte. Plus encore que le siège de Paris (1589), c’est la loi salique et le sentiment national refusant la couronne à une infante espagnole qui sauvent le pays, rallié à Henri IV par la promesse d’abjuration et les sommes dépensées à l’achat des appuis.
La fin du siècle est plus paisible, même si la dernière province ligueuse (la Bretagne) ne se rend qu’en 1598. La même année, l’Edit de Nantes est promulgué. Le redressement économique spectaculaire opéré par Sully amène la bienveillance populaire, mais les Grands recommencent à comploter.
Le premier gagnant de cette « monstrueuse guerre » (Montaigne) est l’absolutisme. Malgré les louvoiements, la personne royale est plus forte que jamais, et Henri IV ne se presse pas de convoquer les États généraux. Les révoltes paysannes et corporatistes ont continué à s’échelonner et à se faire écraser. En revanche, la bourgeoisie urbaine, les détenteurs d’offices et la nouvelle bourgeoisie rurale qui a racheté les terres des paysans endettés et les fiefs des nobles ruinés se trouvent en pleine ascension sociale.
La misère conjuguée à la grande peur des temps fait croître une épidémie de sorcellerie qui affecte toute l’Europe (1560-1630). La sorcellerie est particulièrement enracinée dans les provinces marginales et les montagnes, là où l’autorité royale se fait mal reconnaître.
Même si les catholiques détiennent la palme de la répression, les États protestants et Genève, ainsi que les synodes français, travaillent activement à extirper le mal par le feu. La guerre est finie, mais le règne de Satan continue.

flsh agadir- Directeur du forum
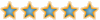
- Messages : 254
Date d'inscription : 18/11/2014
Age : 33
Localisation : agadir
 Sujets similaires
Sujets similaires» le xvi siècle
» le siècle des Lumières
» le 17eme siècle
» L’illusion politique au XXe siècle
» La littérature française du XVIIIe siècle
» le siècle des Lumières
» le 17eme siècle
» L’illusion politique au XXe siècle
» La littérature française du XVIIIe siècle
flsh agadir dllf :: Langue et littérature :: Littérature française, courants et mouvements littéraires, poètes, écrivains
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|
