Connexion
De l'école du jeu à la mort baroque
flsh agadir dllf :: Langue et littérature :: Littérature française, courants et mouvements littéraires, poètes, écrivains
Page 1 sur 1
 De l'école du jeu à la mort baroque
De l'école du jeu à la mort baroque
De l'école du jeu à la mort baroque
L'ascension du livre
L'essor de l'édition au XVI e s., qui paraît avant tout un phénomène culturel, ne doit pas faire oublier que cet art s'est développé aussi comme un marché, à une époque où l'organisation devient capitaliste et soucieuse de profit.
Le développement de l'imprimerie en France
1470 : première presse à Paris, à la Sorbonne. Les réactions face à la nouvelle invention sont alors partagées : si beaucoup d'ecclésiastiques applaudissent à une plus grande possibilité de diffusion religieuse, d'autres la considèrent comme "diabolique".
Le développement des presses est très rapide, et les livres nombreux : cette relative démocratisation fer baisser les prix de deux tiers en un demi-siècle.
Répertoire
La période de 1470 à 1490 est surtout productrice de livres religieux, pour moitié environ. L'autre partie des éditions est formée de manuels, grammaires, dictionnaires, livres scientifiques et "scolastiques"; peu après viendront les impressions de livres populaires, romans de chevalerie, livres de cuisine, calendriers, etc. La présence des livres humanistes se manifeste à.p. de 1480.
Imprimeurs, éditeurs, auteurs
La profession est, au début du XVI e s., assez complète et diversifiée. L'édition proprement dite demande des capitaux plus importants, d'abord fournis par des mécènes avant que les profits du libraire ne permettent l'autofinancement. Beaucoup de libraires-imprimeurs-éditeurs s'associent dans un système de coédition et de correspondance qui multiplie les échanges de livres par trocs, envois et ventes réciproques.
Dans ces débuts, certains nouveaux éditeurs sont en même temps humanistes car, dès que le soin apporté au texte devient plus grand, les artisans font appel à des lettrés qui effectuent les travaux de correction, choisissent les auteurs, distinguent les apocryphes. Ces savants peuvent se mettre à leur compte à leur tour.
La profession d'imprimeur comprend de véritables dynasties, qui essaiment en France selon les mariages.
La marque de l'imprimeur, qui devient un véritable emblème souvent accompagné d'une devise, est aussi importante, sinon plus, que le nom de l'auteur. Sur beaucoup d'ouvrages, celui-ci n'est pas mentionné, et la notion de propriété litt. n'existe pas. L'auteur ne perçoit pas de "droits" et ne peut vivre de sa plume qu'en dédiant son livre à un mécène. Les manuscrits ne se vendront au libraire qu'au début du XVII e s. Mais un certain nombre de livres ne portent aucun nom d'éditeur, d'auteur, ni même de date ou de lieu d'édition : par mesure de prudence, ou par contrefaçon.
Privilèges et censures
Le marché et la profession du livre sont d'abord libres, mais dès la fin du XV e s., 2 problèmes importants doivent être résolus : il faut protéger les libraires et éditeurs contre les contrefaçons, extrêmement pratiquées. Protéger aussi le public contre les "mauvais livres" qui ne tardent pas à semer le doute et la révolte dans les consciences. Les libraires tenteront d'obtenir une réglementation de leur métier vers 1570. L'obtention de privilèges devient courante au début du XVI e s., et accorde l'exclusivité d'un livre à un libraire donné pendant un temps limité, mais les pratiques sont autres, et les saisies rares.
Les privilèges sont accordés par le roi, les parlements ou les juridictions locales, non sans contradictions. Le roi rend le privilège obligatoire en 1563, ce qui tend simplement à accorder une situation de monopole aux grands éditeurs bien vus en Cour.
Les privilèges peuvent contribuer à la censure, mais en sont bien souvent distincts. La Sorbonne censure souvent, le parlement aussi, mais le roi n'entérine pas toujours. Les éditeurs sont souvent plus visés que les auteurs. Malgré tout, cette répression est bien peu de chose par rapport à l'énorme production de livres répandant les idées nouvelles.
Diffusion
On a estimé que le tirage moyen d'un livre du XVI e s. devait se situer entre 1000 et 1500 exemplaires.
Pour aller au-devant de leur clientèle, les libraires utilisent des "facteurs" qui voyagent et représentent la maison ; ils affichent ou distribuent la liste des livres disponibles, ce qui deviendra plus tard le catalogue, et profitent des jours de marché et de fête dans les villes et les bourgs. Un certain nombre s'y installent comme détaillants. En 1490, un tel réseau commercial s'est étendu sur toute l'Europe occidentale.
Présentation matérielle
Les premiers livres (incunables) conservent la présentation des manuscrits : écriture gothique, abréviations, ligatures, usage d'enluminures. Les caractères romains seront vulgarisés par les humanistes, et courants après 1520. Mais le gothique s'utilisera encore tard dans le XVI e s. pour les livres bon marché imprimés avec des caractères usagés rachetés à bas prix. La page de titre apparaît vers 1480, mais la plupart des ouvrages du XV e s. ne sont ni foliotés ni paginés, et la pagination systématique ne deviendra une habitude que dans la seconde moitié du XVI e s..
Les résumés ou les titres-résumés encore fréquents au début du XVI e s. tendent à être remplacés par des tables des matières ou même des tableaux synoptiques qui font un effort de logique.
Les illustrations prennent une importance croissante, car elles sont un argument publicitaire pour les illettrés, et une séduction supplémentaire pour les amateurs d'images.
Dans le livre illustré, un aspect intéressant est la réutilisation des mêmes bois ou gravures pour des livres différents. Cette pratique rend aléatoire, ou du moins plus lâche, le rapport de l'image au texte.

flsh agadir- Directeur du forum
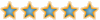
- Messages : 254
Date d'inscription : 18/11/2014
Age : 33
Localisation : agadir
flsh agadir dllf :: Langue et littérature :: Littérature française, courants et mouvements littéraires, poètes, écrivains
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|
