Connexion
Historique de la critique littéraire
Page 1 sur 1
 Historique de la critique littéraire
Historique de la critique littéraire
Historique de la critique littéraire
Deux emplois ; critique journalistique qui porte un jugement sur une œuvre et la critique érudite ou scientifique qui ne porte pas de jugement, mais qui effectue des recherches, analyses, descriptions et interprétations.
La séparation des deux usages est assez moderne. On a fait de Sainte-Beuve le premier critique or il est plutôt le dernier à avoir appartenu aux deux usages : cf. : reproche de Proust d’avoir trop jugé les œuvres et surtout les hommes : critique de l’autobiographisme.
Cependant à partir de Sainte-Beuve, institution d’un certain discours sur la littérature qui cherche à expliquer cette dernière à partir de son contexte d’origine.
La critique journalistique s’occupe plus particulièrement de litt. contemporaine. La critique scientifique de la litt. du passé . on juge les œuvres nouvelles, on expliques les plus anciennes. Le discours historique sur la litt. s’est formalisé dans la seconde moitié du 19ème en Europe et en Amérique du nord. Extension à la litt. médiévale, classique et même moderne. On note donc deux compétences distinctes : évaluatives et descriptives.
A distinguer : une troisième critique : celle des écrivains. La plus importante, qui s’écrit parallèlement aux œuvres litt. Il est devenu banal de rappeler que depuis Baudelaire, Mallarmé, Valéry, Proust, Borgès… tout écrivain est aussi ou d’abord un critique.
Objets et cadres de la critique : Quels critères ?
A noter l’absence de critères explicites et acceptables d’une manière générale. Aspect polémique du champs litt., comme si la théorie obligeait toujours à trancher entre deux options exagérément opposée : évaluation et description. Contexte / texte, forme / contenu,…
Recherche d’une définition de la litt.
Cette recherche est parallèle à celle d’une définition de la critique. Postulat : existence de propriétés des textes litt. qui les distinguent des autres textes.
Ex : la littérarité d’un texte tient à des éléments linguistiques particuliers ou à une organisation particulière du matériau linguistique ordinaire, ou encore à l’origine particulière du texte (auteur).
Attention : toutes ces conditions sont réfutables :
- certains textes littéraires ne s’écartent pas du langage ordinaire
- vice- versa : les traits littéraires se rencontrent aussi dans le langage ordinaire
- idem pour l’organisation textuelle
- critère de l’origine n’est pas valable : logiquement c’est quand on a décidé qu’un texte est litt. qu’on en conclut que son auteur est écrivain.
En fait tous ces critères incluent une évaluation implicite. De fait, on ne peut éviter la question de la valeur lorsqu’on veut définir la litt. et la critique.
Recherche d’un critère de littérarité
La définition d’un terme comme littérature ne donne jamais autre chose que l’ensemble des occurrences dans lesquelles les usagers d’une langue emploient ce terme.
Cependant possibilité d’aller plus loin. Les textes litt. sont ceux qu’une société utilise sans les rapporter nécessairement à leur contexte d’origine. donc : c’est la société qui décide que tels textes sont litt. par l’usage qu’elle en fait. La critique ne saurait constituer tout discours sur les textes, seulement celui qui atteste ou conteste l’inclusion de ces textes dans la litt.
Litt. et critique se définissent toutes deux par le fait que, pour certains textes, le contexte d’origine n’a pas la même pertinence que pour les autres. Du coup toute analyse ayant pour objet de reconstruire les circonstances originales da la composition d’un texte litt. peut être intéressante mais n’appartient pas à la critique. L’étude du contexte d’origine enlève toute litt. au texte qui à l’inverse tenait son qualificatif « littéraire » de la société de laquelle il est issu.
Si la contextualisation historique n’est pas pertinente, la stylistique l’est elle plus ?
Recherche d’une définition du style repose toujours sur opposition populaire de la norme et de l’écart, de la forme et du contenu, soient, des dichotomies plutôt que des concepts. La pertinence stylistique est linguistique et non pas proprement litt.
Finalement la critique litt n’existe pas dès lors qu’on a retiré les discours historiques, polémiques , socio, idéo, psy, et linguistique. Nature impossible à définir analytiquement.
Quand l’analyse ne parvient pas à ordonner, on en appelle à l’histoire : travaux en général illisibles. Une histoire de la critique se heurte aux même obstacles qu’une théorie de la critique. Divers modèles ont tour à tour dominé depuis le début du 19ème, succession mais pas progrès. Ainsi en France, le modèle philologique ou positiviste a suscité par réaction un modèle intuitif dénonçant l’insuffisance de la méthode historique et prêchant la sympathie. Ensuite refusant à la fois le positivisme et l’intuition, des modèles d’explication externes se sont appuyés sur d’autres champs intellectuels, comme le marxisme et la psychanalyse. Puis retour à des modèles immanents, cherchant les lois propres de la littérature dans une analyse de ses structures. Etc … les modèles critiques ne meurent pas et le champ de la critique semble aujourd’hui très ouvert ; pas de paradigme dominant.
La philologie :
Modèle le plus ancien et incontestable de la critique littéraire, perpétué depuis la redécouverte des textes à la Renaissance, étendu aux textes du M-Age au 19ème, puis aux litt. classiques et modernes. Respect de le dernière édition revue par l’auteur, et intérêt aussi pour édition la plus ancienne du texte.
L’histoire littéraire :
Au cours du 17ème , en France, la critique se sépare de la grammaire et de la rhétorique, et remplace peu à peu la poétique, sous laquelle on a parlé de la litt. jusque là. Lié au scepticisme, au refus de l’autorité et des règles, à la défense du goût et aux belles –lettres, la critique au sens moderne, apparaît avec l’esprit historique, lors de la Querelle des Anciens et des Modernes, en réaction contre une théorie rationnelle ou aristotélicienne de la litt. postulant des canons éternels et universels du jugement esthétique. La critique est inséparable du criticisme : cf. : Kant : Critique de la faculté de juger : établissement de la subjectivité du jugement de goût, qui fait cependant appel à un jugement général, au sens commun de l’humanité. Fin 18ème, la critique se présente comme une médiation entre la subjectivité du jugement esthétique et l’objectivité du sens commun.
A son émergence, la critique historique et positiviste, marquée par le romantisme, est relativiste et descriptive. Elle s’oppose à la tradition absolutiste et prescriptive, classique ou néo- classique, jugeant toute œuvre par rapport à des normes intemporelles. Au 19ème, le relativisme est lié à l’affirmation de valeurs nationales et historiques, cf. : De l’Allemagne, de Mme de Staël, ou encore Sainte –Beuve : Critiques et portraits littéraires : explication des œuvres par la vie des auteurs.
Début de la critique sociologique : Taine : explication des individus par la race, le milieu et le moment, cette critique sociologique se développera plus tard dans une perspective marxiste.
Enfin, Ferdinand Brunetière ajoute aux déterminations biographique et sociale, celle de la tradition littéraire elle même, représentée par le genre, qui agit sur une œuvre, ou auquel elle réagit. Brunetière calque l’histoire des genres sur celle des espèces selon Darwin.
La philologie et la critique déterministe partagent l’idée que l’écrivain et son œuvre doivent être compris dans leur situation historique. Au tournant du siècle, Gustave Lanson formula l’idéal d’une critique objective, réagissant à l’impressionnisme de ses contemporains. Loin des grandes lois de Taine et de Brunetière, les sources et les influences deviennent les maîtres mots de l’histoire litt., qui multiplie les monographies. L’histoire litt. lansonienne s’est rétrécie à mesure qu’elle fournissait le cadre de l’approche scolaire de la litt. Ce qui reste déterminant, c'est une conception rationaliste du sujet- auteur présidant à l’oeuvre, et une vision strictement référentielle du langage.
Comme le modèle philologique, l’histoire litt. s’est maintenue. Vers les années 1960, la polémique, à propos de Racine, entre Raymond Picard, représentant la Sorbonne, et Roland Barthes, promoteur de « la nouvelle critique », montra que l’histoire litt. restait un enjeu vivace. Elle demeure très présente, notamment dans l’enseignement de la litt.
Sociologie et psychanalyse de la litt.
Taine rapportait l’individu à ses conditions sociales. Ce sera le principe du tout-venant de la critique marxiste, faisant de la litt. et de l’art un reflet de la situation économique. Cf. : Lucien Goldmann : cette doctrine est devenue plus complexe, dès lors qu’elle a vu les sujets de la création dans les groupes et non plus les individus, mais elle reste foncièrement déterministe. Les socio- critiques contemporaines postulent une autonomie relative des formes esthétiques par rapport aux déterminations socio-économiques. De même que le structuralisme génétique de Goldmann, elles tentent une synthèse avec l’approche intrinsèque du texte. Par ailleurs , l’influence de Walter Benjamin a corrigé par le messianisme ce que la marxisme et la critique idéologique ont d’automatisé.
Enfin sous l’impulsion de Pierre Bourdieu : développement d’une sociologie de l’institution litt. : écrivains, académies, édition, tout l’appareil de la culture, fondée elle aussi sur l’idée de l’autonomie du champ littéraire et entreprenant une science non de la production de l’œuvre mais de la production de sa valeur.
La psychocritique adapte la psychanalyse à une approche contextuelle et offre une variante de la critique biographique, par exemple dans le livre consacré à Edgar Poe de Marie Bonaparte. Bien sûr là aussi on a cherché des compromis avec la critique interne, introduit une « psychanalyse du texte », ou encore une « sémanalyse » : Julia Kristeva.
Les modèles profonds ou interprétatifs :
La critique créatrice : comme le philologie, la critique créatrice est apparue avec le romantisme. L’apologie de l’intuition et de l’empathie, déjà présente chez Herder, était alors dirigée contre le rationalisme classique, non pas contre la critique historique. Il s’agissait de contempler chaque œuvre dans son unicité. Goethe réclamait une « critique des beautés », productive et non destructive. Baudelaire insiste sur la sympathie et voit dans la critique une expression de soi. Mais dès ses débuts, la critique historique a suscité l’hostilité des écrivains. Flaubert protestait contre Taine : « Il y a autre chose dans l’art que le milieu où il s’exerce et les antécédents physiologiques de l’ouvrier. Avec ce système là, on explique la série, mais jamais l’individualité, le fait spécial qu’on est celui-là »
Proust amplifiera cette objection de principe en insistant sur la différence essentielle qui sépare le moi créateur du moi social : à ses yeux, l’artiste n’a rien à voir avec l’homme ; l’intuition créatrice , fondée sur la mémoire et la sensation, avec l’intelligence.
Enfin, Bergson et Valéry sont les précurseurs de la critique antipositiviste de l’entre-deux-guerres en France, attachée aux mécanismes de la création.
La critique des thèmes, de la conscience et des profondeurs
Aux études historiques, qu’il ne juge pas inutiles mais dont il déplore le caractère statique, Albert Thibaudet, marqué par Bergson, veut substituer une analyse du mouvement de la création, par une méthode intuitive et métaphorique. Avec Charles Du Bos, cette mobilité critique devient une soumission métaphysique.
Enfin les Critiques de l’Ecole de Genève (albert Beguin, marcel Raymond et georges Poulet)inspirés a la fois par la critique créatrice française et la phénoménologie allemande, parlent de transposition d’un univers mental dans un autre, de saisie d’une conscience par une autre conscience. Cette identification ne se fait pas avec un texte mais avec une conscience, qui n’est accessible qu’à travers la totalité des écrits d’un auteur. Le temps et l’espace sont les catégories privilégiées de l’interprétation. Jean Rousset et Jean Starobinski ont tenté d’intégrer les structuralisme et la psychanalyse à la critique créatrice. Cette psychologie des profondeurs rejoint la critique thématique française de Gaston Bachelard et de Jean-pierre Richard, fondée sur l’étude des sensations. La catégorie fondamentale reste l’imaginaire et l’hypothèse essentielle est toujours l’unité d’une conscience créatrice, donc de l’œuvre entière d’un écrivain. Toutes les variantes de la critique interprétative ont en commun l’idée qu’une subjectivité profonde, cohérente et unifiée, préside à la totalité d’une œuvre.
Le modèle existentialiste :
Cette critique a préservé les notions d’individus et de subjectivité promues par les écrivains eux-mêmes. Les grandes monographies de Sartre sur Baudelaire, Genet et Flaubert, empruntant au marxisme et à la psychanalyse, maintiennent la primauté de l’homme à travers une série de médiations, comme la famille et les groupes, qui font passer de la totalité à l’unicité.
Malgré les assauts répétés contre l’auteur, l’homme et le sujet conduits par le structuralisme et le poststructuralisme, au nom de Nietzsche et de Heidegger, de Saussure ou de Lacan, l’hypothèse d’une conscience créatrice, fût-ce sur le modèle d’une intentionnalité transcendantale, demeure l’idéologie la plus commune de la critique litt.
On la partage spontanément dès qu’on imagine une unité de l’œuvre d’un écrivain, une unité du livre. L’auteur et le livre restent les croyances les plus répandues lorsqu’on parle de litt. c’est pourquoi la critique interprétative entre moins dans la polémique que la critique historique ou la critique textuelle.
Les modèles textuels ou analytiques :
A partir des années 1960 se dressent des critiques contestant tout empire du sujet, sous sa forme rationnelle ou transcendantale, cartésienne ou phénoménologique, et lui substituant le primat du langage. Une nouvelle conception du langage, venue de Saussure, qui mettait l’accent sur l’arbitraire de la langue et sur son absence de référentialité, a favorisé une nouvelle conception du sujet, désormais pensé comme assujetti au langage ou à la structure, et de la critique, dénonçant l’intention ou l’intentionnalité, refusant de considérer l’auteur comme une instance présidant au sens. Tout cela en fait n’était pas si nouveau. D’une part la parenté est évidente avec les anciennes rhétorique et poétique ; d’autre part, ce retour au texte avait déjà eu lieu partout ailleurs, depuis plusieurs décennies, mais on l’ignorait dans l’hexagone, en particulier à la Sorbonne.
Rhétorique et poétique :
Aristote est l’auteur d’une Rhétorique, ou art du discours public, et d’une Poétique, ou art de l’imitation, qui sont les traités fondamentaux pour toute grammaire du discours ou du texte.
Deux grammaires prescriptives décrivant tous les discours acceptables dans un genre donné et les offrant comme des modèles à suivre pour produire d’autres discours. La Poétique est une théorie normative des formes de la tragédie et de l’épopée. Cette tradition éminente a été peu à peu démantelée. La rhétorique médiévale, située entre la grammaire et la dialectique dans le Trivium des arts libéraux, était encore un art complet du texte. Mais au cours de la Renaissance et de l’âge classique, peu à peu réduite à une seule de ses cinq parties, elle est devenue un traité des figures et des tropes. A la fin du 19ème, elle est écartée de l’enseignement au profit de la discipline historique.
Le projet d’une science du texte apparu dans les années 60 renoue avec la trad. Aristotélicienne, moins son aspect prescriptif, par la volonté d’atteindre des invariants ou des universaux de la litt., par le souci généraliste et théorique opposé au relativisme historique et herméneutique dominant depuis Kant et s’attachant aux œuvres et aux écrivains dans leur particularité. Non seulement la nouvelle critique a remis en vigueur le terme « poétique » pour désigner autre chose que la stylistique et prosodie d’un écrivain : « la poétique de Chénier » ; mais Roland Barthes a même contribué, deux ou trois générations après la mort de la rhétorique , à sa réhabilitation en lui consacrant un vade-mecum.
La linguistique Saussurienne, le formalisme russe, le New Criticism
Pour le nouveau textualisme français, il y a deux ou trois référence plus proches que l’aristotélisme : la linguistique saussurienne, le formalisme ruse, et le new criticism anglo américain, tardivement découverts par une culture littéraire et philosophique parisienne relativement isolée du reste du monde.
Quelques principes, extraits du Cours de linguistique générale de Saussure, sont devenus les articles de foi du structuralisme : l’opposition langue- parole, la conception de la langue comme système de signes, le signe comme opposition de l’image acoustique et du concept (signifiant / signifié), l’arbitraire du signe, la définition du signe comme valeur (comme différence avec les autres signes découpant le monde phénoménal), enfin l’opposition de la synchronie et de la diachronie. Saussure insérait la linguistique dans une sémiologie future qui traiterait des autres systèmes de signes : les principes du saussurianisme vont être ainsi transposés à l’analyse de la litt. et de la culture.
Plus de 40 ans avant le structuralisme français, les formalistes russes (2 groupes de linguistes et poéticiens formés en 1915-1916) puis les membres du Cercle linguistique de Prague (1926-1939) (Roman Jakobson fut la cheville ouvrière de tous ces cénacles), avaient entrepris l’étude systématique de la litt.
1917 : Viktor B. Chlovski : « L’art comme procédé » : leur manifeste.
Sous l’influence du futurisme et contre la poésie symboliste, le formalisme proclame l’autonomie de l’œuvre litt. et de la science de la litt. il s’agit en mettent l’accent sur la litt. comme ensemble de procédés formels, de fonder son étude scientifique en niant sa dimension représentative ou expressive, en dénonçant l’humanisme lié à la croyance en l’unité essentielle du texte et de sa signification.
Ce sont les formalistes qui ont substitué ,comme objet de la critique, la littérarité à la littérature, c’est à dire ce qui fait qu’un texte est un texte litt., ou encore le système de procédés formels qui rend la litt. possible.
La défamiliarisation ou la désautomatisation du langage ordinaire caractériserait la litt., un ensemble de procédés qui bloquent la perception automatique et provoquent une perception poétique du langage. Mais les procédés litt. ne restent pas toujours étranges, ils s’automatisent eux-mêmes. La tradition litt. n’est donc pas immobile ni continue, mais faite de ruptures formelles qui renouvellent le système.
Structuralisme, sémiotique, poétique, narratologie :
Entre Saussure, Jakobson et la critique structurale française, Lévi-Strauss a joué un rôle essentiel de médiateur, appliquant le modèle linguistique à d’autres systèmes culturels, d’abord la parenté puis les mythes. L’analyse du récit pouvait suivre (Barthes, Greimas, Eco, Todorov, Genette, Kristeva).
La poétique et la narratologie visent l’établissement d’une grammaire générale, descriptive et non normative, à la différence d’Aristote et du Classicisme, de la littérature dans son immanence, l’équivalent de la langue dont les œuvres serait la parole.
L’intention est de découvrir les principes généraux dans les œuvres individuelles plutôt que d’interpréter les œuvres individuelles à partir des principes généraux. En ce sens, les expériences les plus réussies paraissent le système du récit établi par Barthes à partir d’une nouvelle de Balzac (S/Z, 1970) ou le petit traité de narratologie dégagé par Genette de l’œuvre de Proust (« Discours du Récit » in Figures III, 1972). Barthes avec ses Eléments de Sémiologie (1964) et son Système à la mode (1967) a étendu ce type d’analyse à d’autres phénomènes culturels. Pour une telle critique, les textes sont un moyen pour définir la litt. ou plutôt la littérarité, comme catégorie universelle.
Stylistique et tropologie :
Apparue au 19ème, la stylistique s’oppose à la rhétorique comme une discipline historique à une théorie générale. Michael Riffaterre : approche de la productivité textuelle s’opposant à la ligne Jakobson – Levi-Strauss.
Après l’essoufflement du structuralisme, c’est dans le domaine de la stylistique que le formalisme reste le plus vivant.
La tropologie remonte au généralisme et se rattache à la Weltliteratur de Goethe, posant l’unité de toutes les litt. occidentales par delà les différences nationales.
L’esthétique de la réception :
Compromis entre hist. littéraire et philosophie herméneutique. Accent sur le lecteur, sur la relation du texte et du lecteur, sur le procès de la lecture.
Husserl ; idée d’une conscience dans la lecture.
Dialogisme et intertextualité :
L’œuvre de M. Bakhtine est contemporaine du formalisme russe mais son influence s’est fait sentir plus tard, après le structuralisme. Bakhtine se démarque des formalistes en décrivant le fait linguistique comme procès social et situation communicationnelle. Insistance sur l’énonciation a pour conséquence de faire apparaître la pluralité de sens des énoncés. Notions de dialogisme, et de carnaval , qui repèrent la polysémie inhérente au langage en action.
Le féminisme :
Le Deuxième Sexe : Simone de Beauvoir 1949.
Second courant féministe, liée à la linguistique : Julia Kristéva. L’attention se porte alors sur la place du féminin dans la langue, et sur les textes des femmes. Questions de l’écriture et de l’expérience féminine sont au premier plan. Jusque là le lecteur modèle est un homme, alors que les femmes apportent une autre expérience à leur attente litt., en questionnant la catégorie d’humaine nature comme principe du sens.

flsh agadir- Directeur du forum
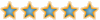
- Messages : 254
Date d'inscription : 18/11/2014
Age : 33
Localisation : agadir
 Sujets similaires
Sujets similaires» le vocabulaire de l'analyse littéraire
» Historique de l'art de la porcelaine
» La dissertation littéraire : quelques instructions à suivre
» Historique de l'art de la porcelaine
» La dissertation littéraire : quelques instructions à suivre
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|
